Peux-tu nous parler de ton parcours, et notamment de ce qui t’a conduit à t’intéresser à l’informatique musicale et à l’art génératif ?
Je viens des sciences : j’ai fait une école d’ingénieur en traitement du signal et en informatique, ce qui m’a amené à faire un DEA à l’Ircam en science appliquée à la musique, qui s’intitulait alors ATIAM (Acoustique traitement du signal informatique appliqué à la musique). Parallèlement à ces études scientifiques, j’ai commencé la musique de manière autodidacte en faisant du rock, plutôt expérimental. C’est à l’Ircam que j’ai commencé à m’intéresser à la musique électroacoustique. Puis je suis devenu assistant en réalisation, notamment pour Georges Aperghis, dont la conception presque visuelle du montage m’a beaucoup marqué. J’ai beaucoup collaboré avec des artistes issus d’autres disciplines, comme Célia Houdart (auteur), Olivier Vadrot (designer scénographe), DD Dorvillier (chorégraphe). Depuis une dizaine d’années, je m’intéresse à une musique qu’on pourrait dire plus conceptuelle, qui prend notamment une forme algorithmique.
Mon intérêt pour ces questions génératives doit remonter au début des années 2000. C’est né d’une réflexion autour de l’écoute, et de ma découverte de Music for Airports de Brian Eno. J’avais été très marqué par une phrase d’Eno qui disait quelque chose comme « avec la musique générative, le compositeur est le premier auditeur de sa propre musique ». M’intéressant de près à l’électroacoustique et à la radio, cette question de l’écoute était pour moi très importante. Je trouvais aussi que j’entendais parfois trop le geste de composition dans certaines musiques électroacoustiques ; je recherchais des solutions pour composer différemment.
J’ai ensuite réalisé un premier disque, très ambient, très Eno. Puis des disques où le montage avait une grande importance, avec un rapport « radiophonique » au texte. J’ai beaucoup collaboré avec Célia Houdart pour ces œuvres dites « radiophoniques » – même si aucune ne fut spécifiquement écrite pour la radio. En électroacoustique, j’avais une certaine difficulté à développer de manière purement musicale, par limitation mais aussi parce que ça ne m’intéressait pas vraiment. Le texte me fournissait alors une ossature sur laquelle je pouvais organiser les sons, en travaillant souvent dans une logique proche du leitmotiv, associant des univers sonores à un personnage, un état d’esprit…
Je crois être assez amateur, de caractère : la collaboration correspond à une profonde curiosité pour les autres formes artistiques. Avec Célia Houdart, on a essayé d’imaginer des choses qui soient à la croisée des disciplines sans devenir un mille-feuilles de disciplines. On souhaitait faire émerger une forme de la rencontre des différentes pratiques, ce qu’on a trouvé avec un ami scénographe, Olivier Vadrot.
Tes différentes collaborations pourraient être interprétées aussi comme le refus d’une certaine forme d’expressivité individuelle…
L’expressivité est mise à distance dans mon travail. Je crois que ce n’est pas tant une volonté qu’une conséquence de ma façon de travailler. Je fabrique des systèmes, des relations, que je mets en activité et que j’observe.
Les collaborations les plus fructueuses sont celles où les individus se mettent au service du projet commun. Par exemple, quand Célia Houdart, Olivier Vadrot et moi-même travaillons ensemble, nous amenons chacun des éléments que nous n’aurions pas développé de la même façon dans notre travail personnel ; il y a la conscience des autres.
Avec DD Dorvillier, nous avons développé lors de nos deux dernières collaborations (Extra Shapes, Only One of Many), une approche différente : le principe est de suivre, indépendamment de l’autre, la même partition pour la danse et pour la musique. Dans Extra Shapes, il s’agit de créer une séquence de 17 minutes pouvant être vue/entendue sous 4 angles différents. Le public se déplace au cours de la pièce pour assister à ces différentes expériences. Dans Only One of Many, nous avons créé séparément 4 séquences : une danse qui ne se répète jamais, une danse qui utilise seulement un mouvement répété, une musique faite de sons qui ne se répètent jamais (sous la forme d’un algorithme développé avec Charles Bascou), un musique répétant le même son. Le public fait l’expérience de toutes les paires possibles entre ces 4 séquences. De chacune de ces combinaisons émerge une matière dont la nature évolue en fonction des paires.
Quelle serait ta première pièce algorithmique ?
Le déclenchement a sans doute été The Two Character Play. Il s’agissait à l’origine d’une pièce de théâtre conçue par la chorégraphe DD Dorvillier, la metteuse en scène Annie Dorsen et la performeuse Anne Juren. Leur idée était de monter une pièce de théâtre de manière parfaitement traditionnelle, puis d’enlever le texte et observer ce qui reste. Une démarche profondément expérimentale. Au-delà de la réalisation artistique proprement dite, le protocole de travail m’a passionné et m’a amené à développer une série de pièces autour du principe de traduction sonore, qui consiste à utiliser une pièce préexistante comme partition pour une nouvelle pièce sonore, en essayant d’avoir une approche la plus objective possible. Par exemple, j’ai créé une pièce intitulée Nouvelle, d’après la Légende de Saint Julien l’hospitalier de Flaubert, où j’ai relevé toutes les phrases sonores dans le texte, les ai classées en quatre catégories (bruitages, paysages sonores, dialogues, musiques) puis demandé à un preneur de son, à une bruiteuse, à des comédiens, à des musiciens, de reproduire cette liste de sons. Le montage final suit les occurrences dans le texte, un peu à la manière de Roaratorio de John Cage. C’est sans doute la première pièce dans laquelle j’ai suivi un protocole du début à la fin. Mon travail est devenu franchement algorithmique à partir des traductions sonores de Sol LeWitt, toute la série des Inevitable Music, autour de 2012.
Comment as-tu découvert les canons de Vuza ?
C’est Fabien Lévy qui m’en a parlé pour la première fois, à Rome en 2015. Moreno Andreatta m’a ensuite donné un patch OpenMusic pour générer les séries, que j’ai programmées dans Max pour faire des simulations avec des sons électroniques. C’est seulement depuis cette année que j’ai imaginé d’en faire des pièces instrumentales.
Qu’est-ce qui t’intéresse dans les canons de Vuza ?
L’idée qu’un canon rythmique qui se transforme en monodie. Apparaît alors ce paradoxe perceptif dont parle Fabien Lévy dans Le compositeur, son oreille et ses machines à écrire : soit on se concentre sur l’écoute des différentes voix pour les écouter comme un canon, comme une polyphonie, soit on les perçoit comme un tout et donc comme une monodie. Cette oscillation de notre perception m’intéresse. J’ai poussé cette réflexion à travers les canons électroniques, où la monodie se transforme en texture sonore. Ce qui était au départ une construction formelle devient pure matière sonore. On évolue d’une perception de la forme à la conscience des formes de perception.
Les canons sont tous construits selon le même principe : les voix rentrent successivement, et une fois que la dernière voix est entrée et s’est combinée avec les autres, le canon s’arrête. Cette structure soutient l’idée d’une musique en train de se faire, comme si l’idée de la musique était dans la musique elle-même, quelque chose que l’on retrouve chez Tom Johnson. Avec les canons de Vuza, c’est comme si la musique exprimait sa propre partition, ses propres règles du jeu. L’idée compositionnelle est inscrite dans l’œuvre elle-même.
Quelles solutions as-tu trouvées pour en faire une utilisation musicale ?
J’essaie de conserver des solutions simples. Dans le canon n°18, chacune des 6 voix forme une descente chromatique qui traverse tout le clavier du piano. Dans le canon n°24 (pour Tom Johnson), l’un des seuls avec un motif mélodique, un mode est choisi, et les notes sont déterminées en fonction de la durée du silence : plus le silence suivant une note est long, plus cette note est grave.
Les solutions pour les canons de Vuza sont des thèmes longs aux rythmes complexes, difficiles à mémoriser. Avec les canons électroniques (canons n°1 à n° 15), j’ai travaillé avec des tempos très rapides qui « resserrent » le thème et permettent d’en avoir une meilleure compréhension. C’est également grâce à ces tempos élevés que j’obtiens les textures finales des canons.
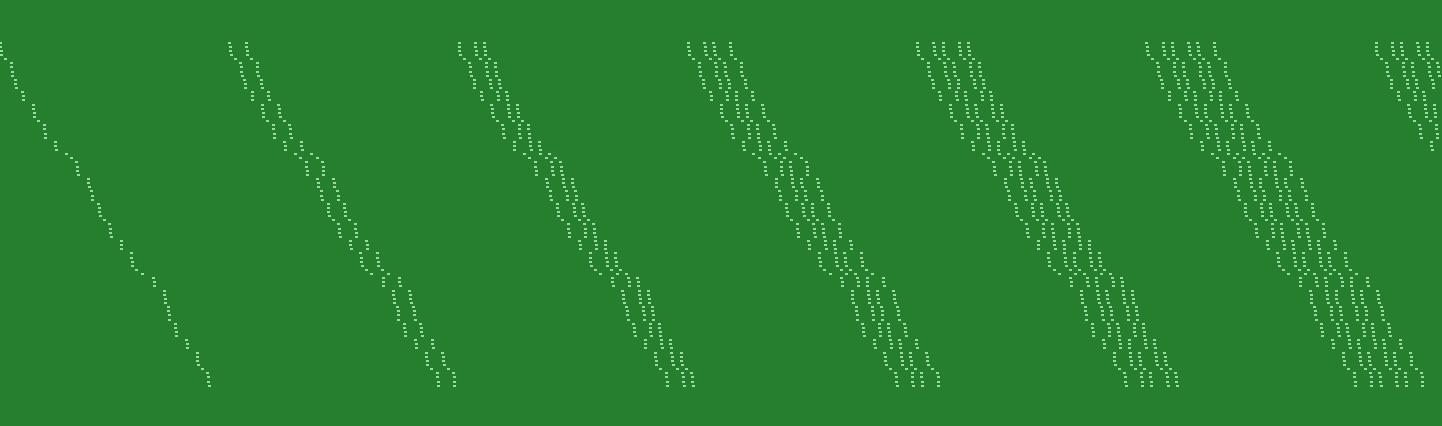
Est-il important pour toi que l’auditeur comprenne la relation entre l’algorithme et sa réalisation sonore ?
C’est un enjeu dans la plupart de mes pièces. C’est à la fois un dessein et une conséquence de mon approche. Du point de vue du compositeur, je cherche une forme de clarté, d’objectivité (évidemment impossibles à atteindre*). Il y a ce désir de dire à l’auditeur qu’il ne sera pas manipulé. Cela passe par la transmission des règles du jeu à l’auditeur.
Cela peut prendre la forme d’une formulation verbale à travers le titre de la pièce (Succession de timbres avec un partiel en commun, never repeated never repeating music…), soit à travers un enregistrement (dans la série Inevitable Music, une voix énonce à l’auditeur comment la pièce est construite), d’une formulation visuelle (partitions graphiques animées). Outre ses formes de médiation, les pièces par leur nature même (par exemple à travers l’utilisation de processus que l’auditeur peut suivre, comme 100 ondes sinusoïdales atteignant 1Khz au même instant) se veulent « compréhensibles »**. Il y a à travers ces stratégies le désir de mettre l’auditeur au travail, de mobiliser une écoute fertile, parfois ludique, productrice de pensée***.
Paradoxalement, en fonction de la nature des pièces, de leur longueur, de leur contexte, la connaissance des règles peut neutraliser cette écoute et l’auditeur peut se retrouver plongé dans une écoute du son pour lui-même, du phénomène sonore pur. Il y a ainsi un jeu d’équilibriste entre conception et perception que j’essaie d’approcher dans chacune de mes pièces (Nelson Goodman nous dit : « Alors que concevoir sans percevoir est simplement vide, percevoir sans concevoir est aveugle. »)
Dans Inevitable Music, l’auditeur travaille à comparer l’énonciation de la partition à son actuelle réalisation. Dans les canons de Vuza, il traverse cette frontière entre écoute analytique et de la pure texture sonore. Avec les 100 ondes sinusoïdales, ces deux écoutes se superposent, il y a la perception (macro) du processus inexorable de jonctions des ondes sinusoïdales et en parallèle, il y a les effets de battements et d’otoémission (micro) inhérents aux interactions des ondes entre elles. Dans Never repeated never repearting music, l’auditeur oscille entre un jeu de comparaison des sons entendus et l’écoute consciente d’une momente forme, sachant que les sons entendus, tous différents les uns des autres et présentés sous la forme d’un catalogue, ne forment pas de discours.
Comment vois-tu la relation entre art visuel et arts sonores ? Quelle place tient l’algorithmique dans cette relation ?
Dans mes traductions sonores des dessins de Sol LeWitt, ceux-ci ne sont jamais montrés pendant le concert, ils sont seulement évoqués par une voix enregistrée. Les musiques sont déduites des œuvres de LeWitt mais ne sont pas là pour les illustrer ; ce n’est pas un jeu de comparaison où l’auditeur peut s’amuser à remarquer les éventuelles différences et se dire : « Tiens, là je n’ai pas entendu le carré vert à droite ». Les dessins de LeWitt sont un peu comme le poème d’une œuvre à programme : il constitue le cœur de la pièce, mais l’auditeur n’y a accès qu’à travers son adaptation musicale. Dans le cas de Inevitable Music, cette adaptation se veut la plus objective possible.
Les partitions graphiques animées, sur lesquelles je travaille en ce moment, mettent en jeu différentes types d’interaction entre regard et écoute. Les partitions sont projetées pour les spectateurs et les interprètes qui donc ont leur regard orienté vers le même objet. Le concert présente une série de pièces, six pour l’instant, présentées comme des études sur le rapport son-image, celui allant en se complexifiant au fil des pièces. La première suit un cheminement algorithmique en explorant toutes les permutations possibles pour 5 musiciens, et explore un rapport de « synchrèse ». Puis sont introduits des signes, comme dans la partition classique, il faut alors un temps d’observation de la pièce pour les interpréter. Le fait de commencer par des pièces où le code est très direct fait comprendre à l’auditeur que toute la musique est contenue dans ce qu’il voit qui est comme un code qu’il va pouvoir déchiffrer. C’est un peu comme si on écoutait la musique en lisant la partition, sauf que c’est un solfège qu’on apprend en découvrant la musique.

Quelle place joue l’humour dans ton travail ?
Sur ce point, j’ai une position assez proche de celle de Tom Johnson ou de James Saunders, qui en parlent comme d’un side effect. Je ne le recherche pas, mais je ne le rejette pas non plus. Par exemple, les canons de Vuza joués récemment par l’ensemble Dedalus ont fait rire certains spectateurs. J’en étais ravi, car il y a une forme de connivence à travers l’humour.
Cette volonté de dévoiler les règles à l’auditeur en temps réel pourrait faire penser à une autre pratique proche de l’art algorithmique, le live coding. Qu’est-ce que cela t’inspire ?
Oui absolument, la recherche d’une objectivité, d’une clarté, d’une transparence. C’est très différent du concert laptop dans les années 90 ou 2000, où les musiciens exagéraient parfois la gestuelle derrière l’ordinateur ou la console de mixage, pour essayer de transmettre quelque chose de leur travail en direct. Mais on ne savait pas trop ce qui se passait derrière l’ordinateur. Là, on dit clairement aux auditeurs : « il n’y a pas de tour de passe-passe, pas de filet de sauvetage, pas de sons préenregistrés, toute la musique est contenue dans ce code ». On peut cependant se demander qui comprend les lignes de commande dans le public. Cela peut devenir un objet de fascination, relevant d’une forme de virtuosité qui n’est pas au centre de mes préoccupations.
Quels langages informatiques, quels logiciels utilises-tu de préférence ? Pour quelles raisons ?
Principalement Max, qui est l’un des premiers langage que j’ai appris, juste après le C et le C++. Pour autant, ce n’est pas l’outil le plus adapté à mon travail, au sens où j’utilise très peu le temps réel. Et il y a pour moi quelque chose de très problématique dans Max, qui vient peut-être de ma façon de coder, c’est la difficulté à relire un patch, un an ou deux ans après. Pour ça, le langage en lignes de code est beaucoup plus efficace, c’est pourquoi je me mets lentement à Python, notamment à travers une librairie audio qui s’appelle PYO, que je trouve plus claire que SuperCollider. C’est avec cette librairie que j’ai fait les 100 ondes sinusoïdales.
Qu’est-ce qui t’attire dans l’utilisation des techniques algorithmiques ?
Ça peut s’intégrer dans une approche de la musique que j’appellerais expérimentale, au sens défini par James Tenney : l’idée de création comme expérience scientifique. Mettre en place un système, observer les résultats produits, et en fonction de ces résultats, établir une nouvelle expérience. J’aime cette approche car j’aime être surpris. C’est quelque chose qui est un peu de l’ordre de la contemplation. Observer les choses et les laisser se développer d’elles-mêmes…
Peux-tu nous parler de tes installations ?
Elles se rattachent davantage à mon intérêt pour le phénomène sonore et la spatialisation qu’à des questions algorithmiques, même si cela reste de l’ordre de la procédure, du système. J’ai initié le corpus Anamorphoses sonores en 2016 en découvrant, dans l’église Saint-Ignace-de-Loyola à Rome, un trompe-l’œil d’Andrea Pozzo représentant une coupole. Il y a dans l’église une plaque de marbre blanc qui indique l’emplacement depuis lequel l’illusion est la plus efficace. J’ai alors cherché ce que pouvait être une anamorphose sonore : un environnement sonore dans lequel l’auditeur se déplace à la recherche d’un point d’écoute depuis lequel cet environnement prend forme (« La métamorphose, c’est le passage de forme à forme. (…) L’anamorphose, on pourrait la réserver à un cas qui est plus profond, à savoir lorsqu’il y a une prise de forme à partir de l’informe. (…) En apparence tout est désordre (…), mais le point de vue, c’est ce qui va extraire une forme. » Gilles Deleuze sur Leibniz, Le point de vue). J’ai réalisé plusieurs expériences, à l’intersection entre le concert et l’installation, au sens où les auditeurs sont conviés à une heure précise, comme pour une représentation, mais se déplacent à leur guise dans l’environnement sonore. Plusieurs anamorphoses sont proposées successivement aux spectateurs-arpenteurs. L’une d’elle, très schaefferienne, reprend l’idée que le timbre ne peut pas suffire pour reconnaître un instrument. On y entend un son résonnant, qui baigne tout l’espace de façon peu localisable, jusqu’à ce que l’auditeur trouve un endroit où il entend une attaque qui se combine avec le son résonant, et comprend qu’il s’agit d’un son de piano. Une autre, que certains ont comparé au fameux “canard-lapin” de la théorie de la Gestalt, propose un son que l’on perçoit, selon le point d’écoute, comme un arpège, ou comme un accord.
Dans Anamorphose #6, deux haut parleurs sont placés à grande distance, et une phrase est diffusée, les phonèmes étant répartis alternativement sur les deux haut parleurs. Tant qu’on n’est pas exactement au centre, on ne peut pas comprendre la phrase, car il suffit de 10 ou 20 millisecondes de décalage entre les phonèmes pour que le sens s’écroule. C’est une phrase de Bob Dylan qui dit : « On ne peut pas changer le présent ou le futur, on ne peut changer que le passé »…
Quelle serait les lieux le plus adaptés à ton travail, à sa dimension expérimentale ? Les lieux de la musique contemporaine ou les lieux de l’art contemporain ?
Cela passe par des rencontres plus que par les catégories. Les partitions graphiques ont été jouées au FRAC Franche-Comté, qui développe depuis longtemps la thématique du temps, et seront jouées au GMEA, qui est un CNCM.
Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir, comme avec l’ensemble Dedalus ou le collectif Générale d’Expérimentation, travailler avec des musiciens dans une approche expérimentale. C’est quelque chose que j’ai beaucoup pratiqué avec les danseurs, qui sont beaucoup plus dans cette approche ; de fait, leur art implique ce temps de l’expérimentation, de la discussion, de la répétition, alors qu’en musique, on reçoit la partition, on la répète deux ou trois fois, on la joue, ce n’est pas du tout la même temporalité.
Quels seraient les compositeurs, artistes, écrivains, qui ont eu un impact décisif sur ton travail ? Ont-ils un rapport avec la création générative ?
Des compositeurs qui usent de protocoles de systèmes : James Tenney, Alvin Lucier, Peter Ablinger, Larry Polansky, qui a fait beaucoup de canons de proportions très beaux, Jean-Claude Risset, Conlon Nancarrow, John Cage, Aldo Clementi, Roland Kayn, Tom Johnson, David Dunn, Warren Burt…
Du côté de l’art sonore : Max Neuhaus.
Parmi les musiciens de ma génération pour n’en citer que quelques uns :
Florian Hecker, dont on ne présente plus l’œuvre électronique.
Alessandro Bosetti, qui travaille sur la voix, je pense notamment à son travail plane/talea où il utilise des micro samples de voix pour fabriquer des polyphonies complexes.
Jean-Luc Guionnet, qui fait une musique expérimentale nourrie de philosophie, qui imagine des processus de composition, tisse des systèmes de relation pour des ensembles d’improvisateurs.
James Saunders qui place la théorie du jeu au cœur de son travail de composition.
Byron Westbrook qui produit des installations sonores où perception et espace sont liés.
Yannick Guédon qui à travers ses compositions à la limite de la performance réduit les choses à leur essence.
Fabien Lévy m’a guidé dans ma pensée, notamment à travers son livre Le compositeur et ses machines à écrire. La lecture du chapitre sur la complexité a été décisif.
Le travail avec mon épouse, la chorégraphe DD Dorvillier et son approche très expérimentale, a aussi été déterminant.
Il y a aussi Lewis Carroll, la littérature oulipienne qui m’a marqué sur les questions formelles, d’écriture par contraintes. Et aussi le cinéma d’Alain Resnais, L’année dernière à Marienbad, Murielle, cette manière de se poser d’abord une question de forme, de poser des règles du jeu pour ainsi dire en faire naître le sujet. Dans les années 2010, j’ai redécouvert les œuvres de Morellet et Sol LeWitt, et voir comment un système simple pouvait produire des œuvres riches et fascinantes, observer comment des œuvres très rigoureuses pouvaient contenir de la poésie et de l’humour, m’ont poussé à plus de radicalité.
Peux-tu nous parler de tes projets ? Ont-ils un lien avec les techniques algorithmiques ?
Les partitions graphiques m’occupent depuis plus d’un an, et se sont incarnées pour la première fois il y a une semaine au FRAC Franche-Comté. Elles seront rejouées avec la Générale d’Expérimentation, ce collectif dijonnais avec lequel je travaille régulièrement. Elles sont amenées à se développer avec différents ensembles. Melaine Dalibert va interpréter les canons de Vuza pour piano. L’ensemble Links va reprendre Adagio Piece, une partition qui tient en deux lignes mais dont l’expérience d’écoute s’étend sur la durée… Enfin, un nouveau disque va sortir sur le label Art Kill Art, Succession de timbres avec un partiel en commun, accompagné d’un texte de Anne Zeitz.
Par ailleurs, une réflexion plus théorique sur les partitions graphiques se mène avec Didier Aschour et Vincent Menu, le graphiste avec lequel j’ai travaillé l’aspect visuel des partitions graphiques. A l’école des Beaux-Arts de Besançon, Daniele Balit, qui travaille sur l’art sonore, m’a invité à mener un projet de recherche. Je vais travailler sur la question de l’écoute en mouvement, comment le son se transforme à travers les déplacements du spectateur. Je réfléchis ainsi à une partition pour auditeur. Graver un disque avec un son continu, un drone, complètement statique, et imaginer des consignes pour l’auditeur, avec des mouvements de la tête, des mains, du visage, du corps…
(Propos recueillis en décembre 2019)
* Il y a cette réflexion de François Morellet au sujet de son tableau 16 Carrés (1953) qui représente 3 lignes équidistantes verticales en intersection avec 3 lignes équidistantes horizontales pour former une grille régulière de 16 carrés : bien que réduite au strict minimum, la pièce nécessite toujours onze décisions arbitraires, comme l’artiste l’a souvent remarqué à bon escient dans ses écrits, pour déterminer son format (forme et taille), son contenu (figure, position horizontale et verticale relative, largeur et nombre), la distribution, couleur (noir ou blanc) et matière.
** Guy Lelong s’entretenant avec Clément Lebrun, citant Daniel Buren : « Lorsqu’il comprend comment c’est fait, le récepteur tend à devenir co-auteur »
*** voir à ce sujet l’article de Mathieu Saladin : « Les sons ne sont pas transparents : approche conceptuelle et réflexivité dans les arts sonores ».
Alessandro Bosetti: The 30 Vuza Canons by Sébastien Roux (english)